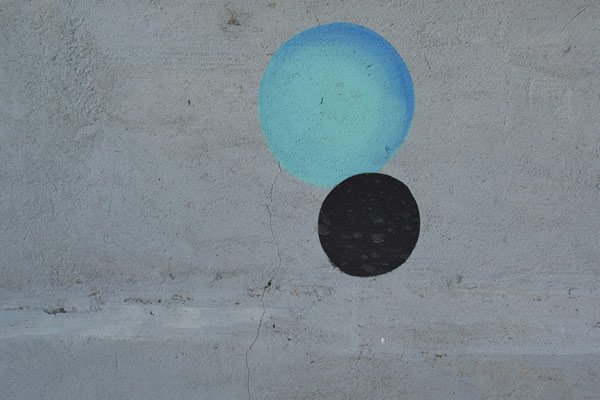Le philosophe Jacques Ellul, dans son ouvrage Histoire de la propagande, explorait les techniques utilisées par les pouvoirs politiques et religieux pour influencer l’opinion publique. Il y distinguait trois grandes périodes avant l’apparition de la propagande moderne où déjà il était question de corruption, de censure et d’instrumentalisation idéologique de la presse.
L’Antiquité et le Moyen Âge
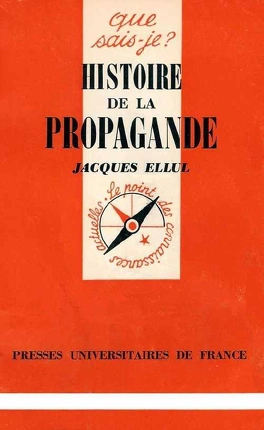 Jusqu’au XVe siècle, la propagande était avant tout liée à la figure du propagandiste, c’est-à-dire à des individus ou à des institutions qui influençaient l’opinion. Dans l’Antiquité romaine, la parole publique était un outil puissant utilisé pour mobiliser le peuple, manipuler les masses, et influencer les décisions politiques. Lors des votes, les orateurs romains recouraient à des moyens peu nobles comme la corruption électorale. Des affiches électorales, vantant les qualités des candidats, et la diffusion d’informations politiques constituaient également des formes primitives de propagande.
Jusqu’au XVe siècle, la propagande était avant tout liée à la figure du propagandiste, c’est-à-dire à des individus ou à des institutions qui influençaient l’opinion. Dans l’Antiquité romaine, la parole publique était un outil puissant utilisé pour mobiliser le peuple, manipuler les masses, et influencer les décisions politiques. Lors des votes, les orateurs romains recouraient à des moyens peu nobles comme la corruption électorale. Des affiches électorales, vantant les qualités des candidats, et la diffusion d’informations politiques constituaient également des formes primitives de propagande.
Rome a également utilisé des symboles puissants, comme des monnaies à l’effigie de l’empereur, pour renforcer son pouvoir et diffuser un message de grandeur et d’invincibilité.
Sous l’Empire romain, la propagande a pris des formes plus structurées. Le mythe de Rome, qui met en avant l’image d’un empire divin, démocratique et vertueux, est propagé à travers les discours et les monuments. À côté de cela, le pouvoir romain a institué des systèmes d’information comme les Acta Diurna, des affiches destinées à informer la population sur les nouvelles politiques et les lois. Bien que ces informations se voulaient objectives, elles servaient des objectifs de propagande.
Plus tard, lorsque l’empereur Constantin adopte le christianisme, la propagande a changé de direction et est devenue un moyen de promouvoir les valeurs chrétiennes face aux anciennes croyances païennes. Ce phénomène de propagande était largement limité aux élites cultivées et n’atteint que rarement les masses populaires. Dans l’Empire romain tardif, la propagande disparaît progressivement, les moyens de diffusion étant de plus en plus centralisés autour de l’autorité de l’État.
La Réforme et l’imprimerie
Au XVIe siècle, l’invention de l’imprimerie a bouleversé la manière dont les idées étaient diffusées. La Réforme protestante, menée par des figures comme Luther, utilisait massivement l’imprimerie pour diffuser ses critiques contre l’Église catholique et pour promouvoir les idées protestantes. Les pamphlets, tracts et brochures permettaient de toucher un large public et d’élargir le champ de la propagande à la population en général. Les idées réformistes n’étaient pas limitées à un petit cercle d’intellectuels mais étaient diffusées parmi les classes populaires, notamment grâce à l’accessibilité croissante de l’écrit, à la suite de l’augmentation du taux d’alphabétisation.
Face à ce phénomène, l’Église catholique a mis en place la censure, pour tenter de limiter l’influence de la propagande réformiste. Dans le même temps, les partisans de la Réforme ont poursuivi leurs efforts de diffusion, non seulement par des brochures, mais aussi par des chansons, des pièces de théâtre et des comédies populaires qui véhiculaient les messages protestants.
Cette évolution a marqué un tournant : pour la première fois, une propagande était diffusée à une échelle de masse, grâce à l’imprimerie. Parallèlement, l’Église a mis en place des structures comme la Congregatio de Propaganda Fide, chargée de diffuser des textes religieux dans les pays protestants et de contrôler la pensée publique, tout en poursuivant la censure des écrits jugés subversifs.
La Monarchie et la Révolution française
À partir du XVIIe siècle, la monarchie française adopte des méthodes de propagande plus systématiques, notamment sous Louis XIV, qui utilise la presse pour diffuser l’image du pouvoir royal. En contrôlant les gazettes et en finançant des publications favorables à son règne, Louis XIV parvient à manipuler l’opinion publique et à renforcer son autorité. Le pouvoir royal se sert de la presse pour créer une version officielle de la réalité, en excluant toute information défavorable. Cette utilisation de la presse pour diffuser un message politique devient un outil central de la propagande, car elle permet au pouvoir de structurer l’opinion à travers un canal largement accessible.
Lors de la Révolution française, la propagande prend une tournure plus radicale et partisane. Les différents groupes révolutionnaires, qu’ils soient jacobins, girondins ou royalistes, cherchent à rallier l’opinion publique à leur cause. La presse devient un champ de bataille idéologique, avec des journaux qui se font la voix des différents partis.
Les journaux patriotes et les pamphlets révolutionnaires jouent un rôle central dans la mobilisation des masses, en appelant à l’action et en désignant l’ennemi commun. Le gouvernement révolutionnaire utilise la presse comme un instrument de contrôle, tout en surveillant étroitement les publications. Cette période marque également l’émergence de la propagande d’État à grande échelle, avec des pamphlets et des actions de sociétés secrètes visant à étendre les idées révolutionnaires au-delà des frontières de la France.
Napoléon et la Propagande d’État
Napoléon utilise la presse non seulement pour diffuser ses victoires militaires, mais aussi pour façonner son image d’empereur. La presse est placée sous un contrôle strict, avec des journaux officiels diffusant les messages du gouvernement, tandis que les journaux d’opposition sont censurés. Napoléon lui-même intervient régulièrement pour diriger les contenus à publier, créant une propagande dirigée et centralisée. Il voit les journalistes comme des agents de l’État, chargés de promouvoir son image et de diffuser des informations favorables à son régime.
En parallèle, Napoléon utilise l’Église catholique comme un outil de propagande, cherchant à rallier les croyants à sa cause. En renforçant les liens entre l’Église et l’État, il consolide son pouvoir tout en diffusant une image de légitimité divine. Cette stratégie de propagande est accompagnée d’une répression sévère de la presse d’opposition, avec une surveillance policière qui surveille les journaux et les publications dissidentes. Après la chute de Napoléon, la presse retrouve un rôle central, notamment sous la Restauration, où elle défend à la fois les libertés et les idéaux de l’Empire.
Le XIXe siècle et la montée du nationalisme
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la propagande prend un tour plus idéologique et nationaliste. Les gouvernements utilisent la propagande pour renforcer l’identité nationale et susciter des sentiments patriotiques. Des thèmes comme l’anti-germanisme, le colonialisme, et l’antisémitisme sont exploités pour rallier les masses à des causes nationales, notamment pendant la guerre franco-prussienne et au début de la Première Guerre mondiale. L’école devient un instrument clé de la propagande républicaine, inculquant les valeurs de la nation et de la République à travers l’histoire, les chants patriotiques et des événements scolaires.
La presse joue également un rôle primordial dans la création d’une conscience nationale, devenant de plus partisane, surtout en période de crises. Lors de la Première Guerre mondiale, la propagande est institutionnalisée des deux côtés du conflit, avec des stratégies de guerre psychologique pour influencer l’opinion publique. Des journaux spécialisés sont créés pour diffuser la propagande dans les pays neutres et occupés, utilisant parfois des informations privées pour attirer les lecteurs.

La propagande révolutionnaire russe, sous la direction de Lénine, applique également ces principes en utilisant tous les moyens disponibles pour mobiliser les masses et promouvoir le communisme, tout en intégrant la notion d’agitation populaire.
La propagande n’était pas limitée à la sphère politique mais visait une subversion générale de la civilisation bourgeoise et de la société capitaliste. Cela incluait une tentative de modification psychologique de l’individu, de son idéologie et de ses structures profondes, car Lénine estimait que le nouvel homme socialiste ne naîtrait pas spontanément mais devait être formé par une éducation orientée et un environnement idéologique.